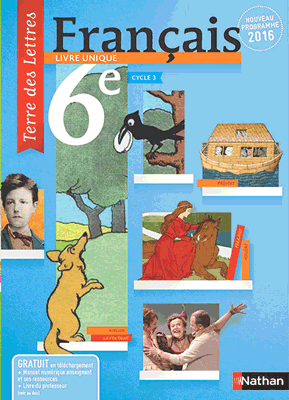sauv.net
· Appel pour le rétablissement des horaires de français.
· Réforme du lycée et enseignement des lettres.
· Des nouvelles du bac et du brevet.
Il est grand temps d’ouvrir les yeux.
Moins médiatique que celle de l’enseignement de la lecture, la question de l’enseignement de la
grammaire n’en est pas moins cruciale. Dans ce domaine-là aussi, l’Éducation nationale n’a eu de
cesse, réforme après réforme, de tout bouleverser, en puisant dans des travaux scientifiques qui lui
servent de caution. Ainsi, dans la dernière terminologie officielle publiée sur le site du ministère (1),
dans la phrase « Je vais à Paris », « à Paris » est un COI (complément d’objet indirect du verbe
aller), et non un complément de lieu, comme le pense encore naïvement une grande majorité de Français …
Il ne s’agit pas là d’une simple question de terminologie. Ce qui est en jeu, c’est toute une conception de la grammaire et de son enseignement. Et, par conséquent, la sécurité des élèves en classe et la confiance des familles en l’école [... pdf ]
Appel à signatures (Lien vers la pétition) !
Eclairages sur l'enseignement de la grammaire, à lire et relire sur le site de Sauver les lettres
Maîtrise de la langue : un enjeu social (Jean-Christophe Pellat)
Grammaire vs linguistique : les préjugés et la raison (Eric Pellet)
- 1er principe : L’instruction de tous doit être la finalité de l’école. L’institution scolaire a pour mission de donner à tous les élèves, quels que soient leur origine et leur milieu, une véritable formation intellectuelle exigeante. Nous considérons qu’elle est défaillante quand, au prétexte de s'adapter à un prétendu «déficit» des plus démunis culturellement, elle propose aux jeunes un simulacre d’instruction, à coup de gadgets pédagogiques et d’activités infantilisantes.
- 2ème principe : Il faut instaurer les conditions d'une égalité réelle des élèves dans l'accès au savoir. Pour réaliser l’égalité d’instruction il faut défendre le collège unique et enseigner les mêmes savoirs avec les mêmes exigences dans tous les établissements du territoire. Ce sont les méthodes qu’il faut adapter aux élèves, non les contenus. (...]
Rejoignez-nous ou soutenez-nous !
L’effondrement du niveau de langue est massif dans le système scolaire depuis plus de dix ans : il concernait hier des élèves de sixième et inquiète désormais des professeurs d’universités, qui constatent un manque de maîtrise ahurissant de leurs étudiants en licence ou en master. Ça, c’est pour ceux qui font des études longues et pratiquent l’écrit. Pour tous les autres : quelle perspective ? Ils surnageront toute leur vie comme ils pourront dans un monde dont ils ne comprendront pas les ressorts (oui, la pensée est liée au langage), et surtout, dans lequel ils n’auront pas voix au chapitre. L’enfermement produit par le manque de mots, le complexe d’infériorité ou la violence qui en résultent, ne sont jamais évoqués par les fanfarons du relativisme, dont on peut imaginer que les enfants en sont évidemment préservés.
Si l’expression orale est le résultat d’inégalités sociales - diverses études ont, par exemple, montré que le nombre de mots maîtrisés par un enfant varie en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de ses parents -, elle en est aussi la cause. Ainsi, malgré des politiques de diversité mises en oeuvre par certains établissements, l’entrée dans les grandes écoles reste une affaire d’élite.
Les réformes orthographiques ont normalement des objectifs d’harmonisation et de simplification. L’écriture inclusive va à l’encontre de cette logique pratique et communicationnelle en opacifiant l’écriture. En réservant la maîtrise de cette écriture à une caste de spécialistes, la complexification de l’orthographe a des effets d’exclusion sociale.Tous ceux qui apprennent différemment, l’écriture inclusive les exclut : qu’ils souffrent de cécité, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, ou d’autres troubles, ils seront d’autant plus fragilisés par une graphie aux normes aléatoires.
Malgré un investissement public conséquent (55,1 Md€ en 2023), les résultats des élèves français en CM1 restent préoccupants, notamment en mathématiques, domaine dans lequel la France se classe dernière parmi les pays de l’Union européenne et avant-dernière au sein de l’OCDE. Plusieurs dysfonctionnements structurels ont été identifiés, au premier rang desquels une aggravation des inégalités au cours de l’école primaire, une gouvernance de l’école encore trop centralisée, une organisation du temps scolaire en décalage avec les besoins des élèves, ainsi qu’un recul de l’attractivité du métier d’enseignant.
Pourquoi avoir plongé les deux pieds en avant dans un système qui ne met pas l’enfant au centre de la réflexion ? Le mystère n’est pas très épais. La droite, sous Nicolas Sarkozy par exemple, mais aussi avec Jean-Michel Blanquer, a préféré privilégier les intérêts économiques du pays, notamment du secteur touristique. Qu’importe le bien-être, et donc la capacité de concentration, des enfants.
Un des grands drames de l’École est qu’elle a introduit un ensemble de croyances sociologiques au coeur de son dispositif éducatif et qu’elle fonctionne, trop souvent, au gré de théories des déterminismes sociaux et des antériorités des multiples formes des milieux dits « familiaux », oubliant ainsi l’ontologie simple et universalisante de l’élévation. […] Ce n’est pas parce qu’il y a ici des mécanismes d’inégalités sociales que l’École doit modéliser ses missions ou se construire à partir de ceux-ci. C’est dire le rôle principiel et archétypique que je crois nécessaire de redonner à l’École, en tant qu’elle est le lieu du Savoir.
Si, dit-il, « les savoirs passent à la trappe », si la perspective humaniste a quitté l’école, si les activités extra-scolaires et l’idéologie modulaire des « compétences » l’envahissent, c’est que les réformateurs sont les agents de forces puissantes qui font de l’école un appendice du marché du travail. Et puisque « dans une société de marché le politique est subordonné à l’économie », il est vain d’espérer une autre politique scolaire.
L’enseignement secondaire professionnel ambitionne d’aider les élèves à « trouver leur place » sur le marché du travail. S’agit-il vraiment de leur faciliter l’accès à l’emploi, ou bien de leur faire accepter un statut de dominé ? (…) Un professeur explique : « le nombre d’heures d’enseignement en histoire-géographie a été réduit d’à peu près un tiers (…) et passer l’examen ne consiste plus qu’à apprendre par coeur certains points factuels. Comme si finalement ces élèves-là n’avaient pas besoin de développer un esprit critique. En français c’est pareil. Maintenant on nous demande faire du français utilitaire ».
Des épreuves trop faciles. Le ministère de l’Education nationale a publié les nouvelles maquettes de CAPES. La nouvelle maquette du CAPES de lettres modernes fait beaucoup réagir la communauté enseignante. Avec une nette baisse des exigences par rapport à l’ancien concours, pour les professeurs, ce nouveau CAPES est un concours « au rabais » : on compte 3 oeuvres littéraires indicatives [...] ainsi que 2 oeuvres artistiques indicatives. A titre de comparaison, dans les années 2000, il n’y avait pas de programme : il y avait « 5 siècles de littérature et des critiques à connaître, pour pouvoir faire une dissertation de littérature générale de 6h », déplore un professeur.
Le problème n’est pas nouveau mais les propositions, toujours plus étonnantes. Le rectorat dijonnais compte confier, en septembre et “à titre expérimental”, des cours de français à des enseignants d’autres matières. Un examen oral de trente minutes et des « études littéraires à un moment donné » suffiront pour obtenir l’attestation « Enseigner le français ». « L’Éducation nationale, plus grande enseigne de bricolage du pays », ironise le Snes-FSU. Dans un communiqué furibond intitulé « Attractivité : le ministère et les rectorats n’ont que de mauvaises idées », le premier syndicat du second degré étrille [l’] institution.
Communiqué de presse du 9 avril 2018 (APL, CNARELA, Sauver les lettres)
[…] Une note de service du 19 mars [2018] instaure une « certification complémentaire » dans le « secteur disciplinaire » des langues anciennes, permettant aux professeurs d'autres disciplines, « en particulier ceux des disciplines lettres modernes, histoire et géographie, philosophie et langues vivantes étrangères » d'enseigner le latin et le grec - sans formation spécifique disciplinaire, didactique ni pédagogique, sans concours, au seul titre de leurs souvenirs scolaires ou parfois d'une teinture universitaire de quelques semaines[…]
Le ministère semble ne pas comprendre qu’un professeur qui ne maîtrise pas sa discipline ne pourra jamais enseigner correctement, ce qui montre sa déconnexion totale avec la réalité de l’enseignement. Tout se passe comme si le ministère ne se souciait guère du niveau disciplinaire des futurs candidats aux concours de recrutement et qu’il entretenait le préjugé selon lequel il suffit pour enseigner d’exécuter quelques recettes apprises. Il prétend, contre toute logique, améliorer le niveau scolaire des élèves en réduisant les exigences disciplinaires dans la formation des futurs professeurs.
Alors que plusieurs États américains ont supprimé, puis rétabli l’apprentissage de l’écriture manuscrite dans les écoles en 2017, une nouvelle étude met en lumière l’importance du geste d’écriture dans l’acquisition de certaines compétences chez les élèves. Les enfants qui écrivent à la main décodent mieux les mots. Publiée en mai 2025 dans la revue scientifique Journal of Experimental Child Psychology, l’étude suggère que les enfants pratiquant l’écriture manuscrite acquièrent une représentation plus précise des lettres et des mots que ceux qui utilisent un clavier pour écrire. Écrire à la main serait également bénéfique pour l’apprentissage de la lecture, puisque cela favoriserait l’identification et le décodage des mots, et, pour ceux qui ne savent pas encore lire, cela permettrait d’établir de meilleures correspondances entre les lettres et les sons.
Alors que plusieurs États américains ont supprimé, puis rétabli l’apprentissage de l’écriture manuscrite dans les écoles en 2017, une nouvelle étude met en lumière l’importance du geste d’écriture dans l’acquisition de certaines compétences chez les élèves. La syllabique ainsi pratiquée introduit au sens et à la compréhension bien avant toute autre démarche qui – au nom du sens et de la compréhension – impose une reconnaissance visuelle de mots entiers, celle-ci étant inévitablement très dispendieuse en temps (et de plus d’une efficacité très peu certaine). La syllabique apparaît de ce fait la mieux placée pour reprendre à son compte l’injonction du « Lire c’est comprendre », originellement vouée à la chasser du système éducatif.
La question de l’efficacité du numérique est envisagée et l’auteur explique que, si retombées positives il y a, elles sont modestes. De plus des études récentes montrent que la mémorisation et la compréhension d’un texte sont meilleures sur papier que sur écran.